
La Premier League fête ses 30 ans : retour avec l’accent belge sur l’évolution de cette prestigieuse compétition
Au pays des deuxièmes ballons et des sacoches des quarante mètres, des espaces infinis et des défenses qui ne défendent pas vraiment, l’arrivée de la Premier League il y a trente ans a tout changé. Transformant en trois décennies le football archaïque anglais en chantre de la modernité. Retour avec l’accent belge sur trente ans de bitures, de mondialisation accélérée et de coup d’épaule dans la surface.
Au début des années nonante, on disait encore que quand les Anglais parlaient de coaching, les sujets portaient d’abord sur le timing des changements et la seule gestion de deux phénomènes locaux portés aux nues outre-Manche: le supersub et le franchise player. En gros, à l’étranger, le cliché véhiculé voulait que les coaches anglais soient avant tout vu comme des pantins hors de prix. Des gentlemen à la Bobby Robson, mais de lamentables tacticiens. Foutue époque où le meilleur des 4-4-2 à plat pratiqué à la sauce british faisait toujours gentiment ricaner les disciples du football façon Arrigo Sacchi ou Johan Cruijff.
OK, on a perdu, mais on n’a pas a été si mauvais que ça pour des gars qui revenaient de cinq jours de bringue avec Chris Waddle. » Marc Degryse
Des références qui résument alors à elles seules la domination du football latin sur ce qu’on nous a longtemps vendu comme un vulgaire kick and rush façon cours d’école. Comme si on pouvait avoir inventé un sport et en devenir sa caricature. Oubliées les neuf finales de C1 disputées en onze ans entre 1975 et 1985, le vrai visage du football briton est celui d’un lendemain de veille. Stigmate d’une soirée qui a mal tourné au Heysel et d’un sport national déshydraté.
S’imaginer que quand la Premier League sort de terre à l’aube de la saison 1992-1993, aucun des représentants de la couronne ne passera ne fût-ce que l’hiver au chaud sur la scène européenne suffit à matérialiser le malaise. Sans compter que les Three Lions de Graham Taylor viennent de traverser l’EURO 1992 organisé en Suède en fantôme. Terminant derniers de leur groupe, sans la moindre victoire et avec un seul tout petit but marqué. Le football anglais est sous respirateur artificiel et tout le monde se marre.
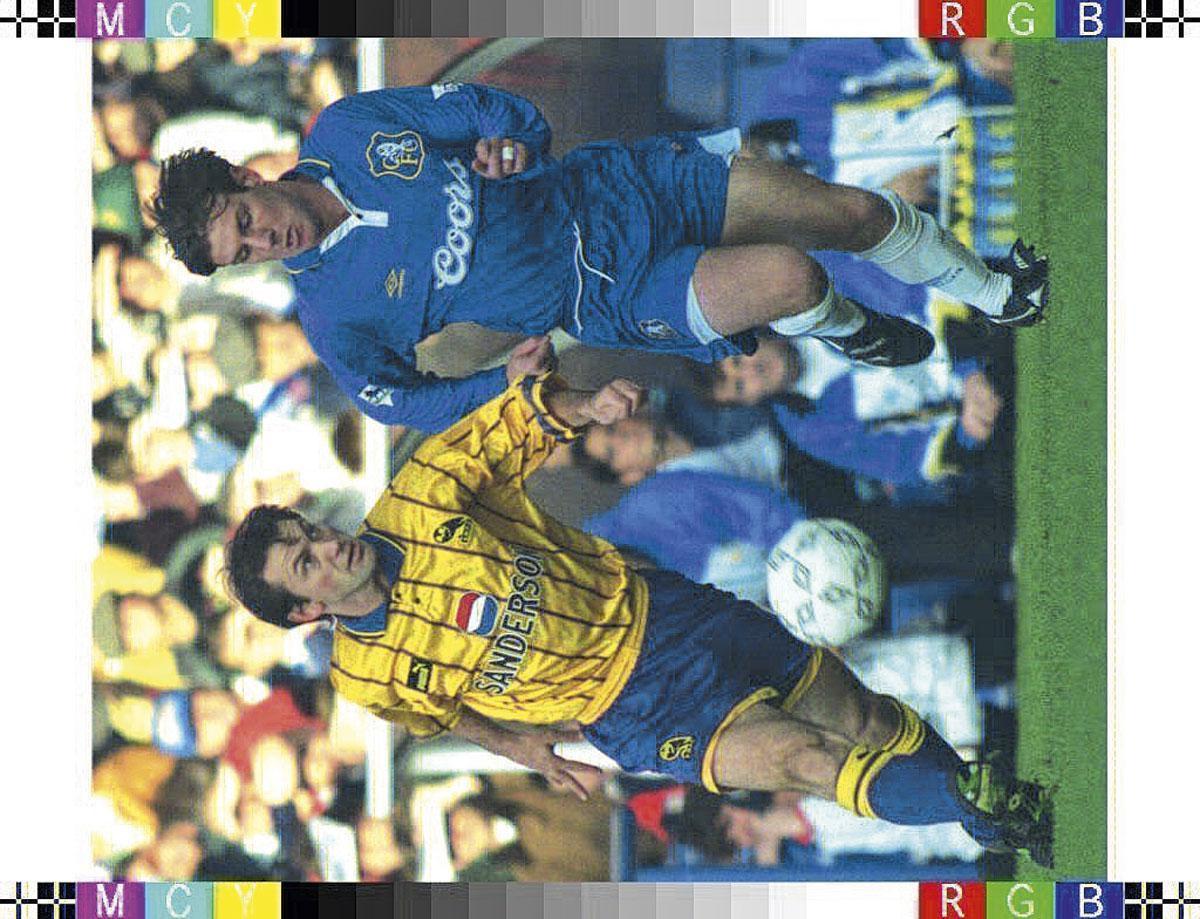
Tout le monde, sauf ceux qui vont sentir le fruit bientôt mûr. Parmi eux, une pelletée de footeux étrangers arrivés à petite dose dès les premières saisons, mais débarqués en masse à partir de l’hiver 1995 au lendemain de l’arrêt Bosman. « Gamin, j’avais ces souvenirs de ces finales de Coupe d’Angleterre commentées par Franck Baudonck à la RTB« , se souvient Philippe Albert. « Il y avait des buts extraordinaires. C’était Norman Whiteside pour Manchester United, c’était une finale gagnée par Coventry, une autre par Tottenham ou le grand Liverpool… Quand l’opportunité est arrivée d’y aller à mon tour, je l’ai saisie à deux mains. Je ne pouvais pas refuser d’aller là-bas. La Premier League venait de démarrer. C’était déjà un football populaire mais là, le monde entier pouvait le regarder! »
La planète entière verra donc Philippe Albert se faire attraper le colback par Eric Cantona lors du Charity Shield 1996. Ancien coéquipier du bûcheron de Bouillon à Anderlecht, Marc Degryse restera coincé une saison de plus à Bruxelles avant de découvrir Sheffield Wednesday. « Philippe et Luc ( Nilis, au PSV, ndlr) avaient reçus leur bon de sortie après la World Cup américaine, mais moi j’ai encore dû rester une année. Ça ne parait rien une année, mais quand je suis arrivé en Premier League, j’avais déjà trente ans. Quelque part, c’était déjà trop tard pour y faire une grande carrière. J’en ai profité, ça oui, mais il y aura toujours un goût de trop peu. »
On dit que quand on goûte à la reine des compétitions, tout le reste parait fade à côté. Pour Marc Degryse, l’expérience vécue dans la foulée de son année anglaise, à Eindhoven, n’aura en tout cas rien de comparable. À Sheffield, l’homme aux cinq titres de champion de Belgique découvre surtout une autre manière de consommer son sport. Comme cette fois ou après une défaite contre QPR à la maison, le coach David Pleat annonce à ses troupes qu’il a vingt billets d’avions dans sa poche pour aller passer quelques jours ressourçants à Marbella. « On est partis le dimanche, mais le coach n’a même pas pris la peine de venir avec nous », restitue Degryse. « Il nous faisait une confiance aveugle. Il nous avait dit un truc du genre: Reposez-vous, mais je vous attends tous de pied ferme vendredi matin à l’entraînement. La folie, c’est que le samedi, on jouait contre le Tottenham de Klinsmann. Alors, OK, on a perdu, mais on n’a pas a été si mauvais que ça pour des gars qui revenaient de cinq jours de bringue avec Chris Waddle ( Il rit). »

Liberté, égalité, mal de crâne
Une certaine idée du professionnalisme impensable à l’époque en ce bon Royaume de Belgique, temple de la mise au vert et des doubles séances quotidiennes, mais qui fait alors recette en Angleterre. Pour preuve, quand Cédric Roussel découvre à son tour les coutumes locales à l’été 1999 en débarquant à Coventry, l’international Espoir sort d’une préparation chahutée avec le Gand de Trond Sollied, un Norvégien plutôt ponctuel. « Quand on jouait à domicile, Sollied nous demandait de nous pointer à 10 h du matin au stade, alors que le match était à 20 h! J’avais déjà 21 ans, mais c’est quand je suis arrivé en Angleterre que j’ai pour la première fois eu l’impression d’être traité en adulte. Là-bas, on nous faisait beaucoup plus confiance. Quand il y avait des mises au vert, on terminait systématiquement au bar jusque 23 h ou minuit, mais il n’y avait pas d’excès. On allait aussi manger quand on voulait. Quand on avait faim, en fait. Et puis, évidemment, quand on jouait à la maison, on nous demandait simplement d’arriver 1h30 avant le coup d’envoi. C’était hyper pro et en même temps super relax. »
Je n’imaginais pas à l’époque la puissance du championnat anglais. » Christian Benteke
Derrière les pintes que Cédric Roussel s’envoie en terrasse jusqu’à pas d’heure, le futur striker montois abandonne quand même « huit à neuf kilos en six semaines. » Un régime drastique, mais sans les soupes aux lentilles. « On avait qu’une séance par jour, mais elle pouvait parfois durer jusqu’à trois heures. Les premiers entraînements, j’en ai chié. Je rentrais chez moi, je me couchais et je dormais jusqu’au lendemain. »
C’est probablement parce qu’il n’a plus le temps de manger que Cédric Roussel débutera sa « période faste » à l’occasion du derby contre Aston Villa, fin novembre. Plus que son but de la tête inscrit à David James, Roussel n’oublie pas le charme de ce qu’on appelle alors pompeusement le Monday Night football. « On jouait le lundi soir, ça semble anodin, mais c’était incroyable pour nous, parce que ça disait tout du spectacle qu’était déjà la Premier League! C’était complètement novateur à l’époque de voir des matches déplacés à des tranches horaires particulières pour qu’ils soient vus par le plus grand monde. On n’était plus de simples footballeurs, on était des acteurs. »

Une déclaration d’amour au spectacle vivant partagée par tous les pionniers présents en Angleterre courant des années nonante et après. Parmi ceux-ci, un certain Nico Vaesen, débarqué au Royaume-Uni à l’été 1998, au crépuscule d’une carrière belgo-belge jusque-là anodine. « Je sortais d’une longue blessure au poignet quand j’ai été invité par un intermédiaire à venir voir un match d’Huddersfield, alors actif en First Division ( l’équivalent de la Championship aujourd’hui, ndlr). Je m’en souviendrai toute ma vie. Il y avait 15.000 personnes, c’était juste fou. Tous les gens de la ville étaient au stade. Et ceux qui n’y étaient pas s’étaient réfugiés dans les pubs du coin. Mais surtout, c’était un samedi après-midi! C’est-à-dire que dans la foulée, on avait notre soirée pour sortir, et la possibilité de passer le dimanche tranquille en famille. »
Qualité de vie
À l’aube des années 2000, le championnat anglais est non seulement bientôt le meilleur du continent, mais aussi le plus attractif au niveau de la qualité de vie. La preuve que le football britannique a réussi son entrée dans le siècle mieux que les autres et qu’il faudra désormais se lever tôt pour le concurrencer à nouveau. « Aujourd’hui encore, la flexibilité de la Premier League n’a pas d’équivalent », valide d’ailleurs Christian Benteke, le joueur belge à compter le plus d’apparitions en PL (276). « Les joueurs sont attachés à cette souplesse parce qu’ils savent que ça n’existe pas ailleurs. Quand j’étais au Standard, on m’obligeait à faire la sieste à l’académie avant les matches. Ici, tu viens au stade et tu fais ton match, point. L’avantage principal, c’est que tu arrives au stade avec une fraîcheur mentale, sans avoir eu le temps de cogiter. Ce n’est pas toujours bon de trop réfléchir… »
La recette fonctionnera encore un peu mieux que d’habitude avec le Liégeois. Souvent décrié en Belgique avant son départ, il facture une première saison anglaise à 23 roses sous le maillot d’Aston Villa. « Je n’imaginais pas à l’époque la puissance du championnat anglais. D’un coup, ma vie a changé. Rien que le jour de mon transfert, le club m’avait mis un avion privé à disposition, qui était venu me chercher à l’aéroport de Bierset. Pour moi, monter dans un jet privé, c’était déjà impensable. Je crois que c’est pour ça que ça a marché. J’avais envie de faire en sorte que ce ne soit pas un feu de paille. »
Big Ben a donc enchaîné les pions, s’est mis à la gymnastique pour travailler sa mobilité, a pris cinq kilos de muscles en quelques mois et est devenu la nouvelle terreur made in Belgium des défenses locales. « Je crois que ma force, c’était aussi que personne ne me connaissait. J’en parlais parfois avec Marouane ( Fellaini, ndlr), qui avait aussi connu ça un peu avant moi. J’ai su profiter de cette période. Aujourd’hui, les attentes sont plus élevées avec les jeunes Belges. D’un autre côté, quand je vois jouer un Trossard, je me dis que c’est un super beau joueur, mais qu’il n’aurait peut-être pas eu sa place en Premier League il y a dix ans. »

La parole sincère d’un homme qui a voué une admiration sans borne à des joueurs de la trempe de John Terry ou Vincent Kompany, mais qui n’a jamais autant sué que face au Stoke City de Ryan Shawrcoss. « Des équipes comme Stoke City ne cherchaient pas à jouer au foot à l’époque. C’est en ça que je pense que des plus petits formats auraient eu du mal il y a dix ans. Et c’est en ça que la PL a évolué tactiquement. »
Old School Football
Une évolution que l’on doit principalement à l’arrivée massive de techniciens étrangers de renom au cours de la dernière décennie, et qui semble devoir faire perdurer la statistique cruelle qui rappelle chaque année qu’aucun coach anglais n’a jamais remporté la Premier League.
Avec 31 apparitions pour Birmingham City en Premier League début des années 2000, Nico Vaesen a plutôt connu le foot british old school. Trop court pour la Belgique, celui qui de son propre aveu n’avait « rien d’un Courtois ou d’un Mignolet » trouvera en Angleterre un championnat taillé sur pièce pour son quasi double mètre. « Le fait est que j’étais respecté grâce à ma taille. Je me souviens encore de cet entraîneur qui me répétait à longueur d’entraînement. Si tu as dix balles dans le box , je veux que tu y ailles dix fois. Même si tu te rates, tu y retournes. Bon voilà, ce qui était clair, c’est qu’on ne parlait pas encore de jeu au pied à l’époque ( Il sourit). On recevait la balle et on envoyait une croquette devant. »
On ne parlait pas encore de jeu au pied à l’époque. On recevait la balle et on envoyait une croquette devant. » Nico Vaesen
Un petit jeu qui n’a jamais fait beaucoup rire Marc Degryse. Joueur élégant, profilé pour séduire, le lutin d’Ardooie a pour lui d’intégrer une des premières équipes de la colonne de droite de Premier League à tenter de jouer au ballon. C’était au cours de la saison 1995-1996 avec le Sheffield Wednesday de David Pleat. « Ce n’était pas un coach anglais comme les autres. Il voulait changer les choses. Il avait d’ailleurs construit son équipe dans cette optique. En allant chercher quelques bons joueurs offensifs comme Chris Waddle et moi-même. Par contre, nos défenseurs, c’était encore l’ancienne école. Du genre pas très à l’aise avec le cuir. Donc en gros, l’équipe était coupée en deux. Derrière, ils balançaient. Devant, on se bagarrait pour le deuxième ballon. Mais quand on avait la chance de le récupérer, on était parmi les plus beaux à voir jouer. »

C’est parce que tout ce qui est rare est cher que la Premier League des années nonante est un laboratoire géant à ciel ouvert. Suffisamment clinquant pour attirer certains regards, mais pas encore assez élitiste pour faire l’unanimité. Sur une voie de garage à La Gantoise après l’arrivée d’ Ole Martin Arst, Cédric Roussel part ainsi à la conquête des Midlands de l’Ouest et de Coventry avec pour but principal de s’y refaire une santé. Mais si sa première saison est un succès d’estime, elle ne lui ouvre pas pour autant les portes des Diables rouges et de l’EURO 2000. Ce que le principal intéressé digère toujours aussi mal 22 ans plus tard. « Sincèrement, vous verriez aujourd’hui un jeune attaquant belge de 21 ans marquer six buts en PL pour sa première saison et ne pas être repris avec les Diables? Même Branko Strupar, contre qui j’avais joué cette saison-là, m’avait dit ne pas comprendre les choix de Robert Waseige. Mais le problème, c’est qu’à l’époque, il n’y en avait que pour le Big Four. Le reste n’existait pas. On vivait dans l’anonymat complet. »
Malgré ses quatre apparitions en Premier League avec Southampton lors de l’exercice 2012-2013, Steve De Ridder n’est, lui non plus, jamais sorti de cette obscurité tranquille. Débarqué « un peu par hasard » en Angleterre alors qu’il aurait dû initialement prendre la direction de Zulte Waregem, l’actuel joueur de Saint-Trond assure avoir vécu pleinement son rêve. « Quand je suis arrivé de De Graafschap, le club venait d’être promu en Championship. Rien ne laissait penser que douze mois plus tard, j’en serais à jouer contre Arsenal ou à faire un poteau contre Chelsea. Mais au final, je peux dire que j’ai joué avec Adam Lallana, Jose Fonte ou Morgan Schneiderlin. Je me suis garé à côté de gars qui venaient à l’entraînement en Bentley et en Ferrari. Donc quelque part, j’ai vécu mon rêve. »
Comme quoi, on peut avoir le même maillot, la même passion, mais pas forcément le même compte en banque. Heureusement, ça n’enlève pas les étoiles dans les yeux. Peut-être parce qu’avant d’être un produit de consommation bling-bling qui fait rêver les touristes du monde entier, la Premier League est un théâtre qui donne la chair de poule à ceux qui s’y produisent. De Cristiano Ronaldo à Steve De Ridder.
Des numéros 10 avec un petit ventre
Arrivé en Angleterre via la Qatar, Emile Mpenza passera un an et demi du côté de Manchester City entre février 2007 et le rachat du club par des fonds émiratis à l’été 2008. « Quelque part, je pense avoir connu la dernière saison du football anglais 1.0. Le rachat de Chelsea ( en 2003, ndlr), puis de City, a fait passer la Premier League dans une nouvelle ère. À mon époque, tu avais encore des défenseurs qui étaient juste des montagnes de muscles et des numéros 10 avec un petit ventre. Je jouais attaquant, mais si je m’étais bien battu et que j’avais donné un coup d’épaule ou réussi un joli tacle, les supporters oubliaient que je n’avais pas marqué. Ce qu’ils voulaient, c’est que je me défonce. Tout était encore dans l’intensité. »
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici
